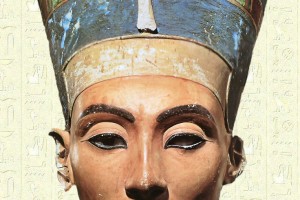A travers l’incroyable histoire de la «Fuite en Egypte» de Nicolas Poussin, le sociologue Bernard Lahire raconte comment une croûte devient tableau d’exception.
Le Pape Innocent X de Vélasquez au Grand Palais, le Moïse de Poussin au Louvre, le Cri de Munch à la Fondation Louis-Vuitton (1)… En ce moment, des milliers de spectateurs se pressent pour admirer les grands maîtres. Mais, c’est quoi, un chef-d’œuvre ? Dans Ceci n’est pas qu’un tableau, Bernard Lahire, professeur à Normale Sup Lyon, retrace l’histoire rocambolesque d’une peinture de Nicolas Poussin, une Fuite en Egypte au voyageur couché, aujourd’hui exposée au musée des Beaux-Arts de Lyon. A travers lui, le sociologue scrute les mécanismes qui transforment un objet – des pigments posés sur une toile – en relique sacrée.
Votre livre raconte un conte de fées. En 1982, un chef-d’œuvre de Poussin apparaît sur le marché. Il relègue alors le tableau que les experts considéraient jusqu’ici comme le «vrai» au rang de copie. La famille qui pensait posséder une croûte se retrouve avec de l’or entre les mains… Derrière ce récit, vous dévoilez une affaire de rapports de force et de croyances collectives. C’est magique ?
On sait que Nicolas Poussin a peint, en 1657, une Fuite en Egypte. En 1665, Le Bernin, grand sculpteur italien admiratif de Poussin, est très critique face à cette toile : «On devrait s’arrêter de peindre, avant de peindre des choses pareilles», dit-il. Le premier avis autorisé est donc négatif. A la mort du commanditaire, l’œuvre a déjà disparu. Le mystère s’installe.
Siècle après siècle, des «Fuite» et des «Repos en Egypte» apparaissent sans qu’on sache si l’un d’entre eux est «le» tableau peint de la main de Poussin…
Jusqu’à ce qu’en 1982, un Anglais, sir Anthony Blunt, le «pape» des poussinistes et le conservateur de la collection de la reine d’Angleterre, affirme à propos d’une toile réapparue qu’il s’agit du tableau de Poussin. Il appartient à une riche collectionneuse américaine, Mme Piasecka Johnson. Mais, une deuxième toile apparaît en 1986, à l’occasion d’une vente aux enchères à Versailles. Elle est mise en vente à 80 000 francs, en étant désignée comme une copie de bonne facture. La famille qui la vend se débarrasse d’un objet encombrant, pensant que la peinture religieuse «ne vaut rien». Pierre Rosenberg, qui deviendra président du Louvre, affirme à l’époque que le tableau n’est pas de Poussin. Il est acheté par des marchands de tableaux français, les frères Pardo, pour la somme de 1,5 million de francs. Le prix «parle» de lui-même. Il dit : «Nous parions que ce tableau est le vrai.»
S’ouvre alors une bataille pour savoir quelle toile doit être sacrée comme le chef-d’œuvre de Nicolas Poussin ?
Une controverse s’installe avec, d’un côté, les Anglo-Saxons, emmenés par Blunt et un autre poussiniste, sir Denis Mahon, qui défendent le tableau Piasecka Johnson et, de l’autre, deux experts français : Jacques Thuillier, professeur au Collège de France, et Pierre Rosenberg, qui, entre-temps, a changé d’avis sur l’authenticité du tableau. La bataille des Fuite en Egypte commence. Des laboratoires scientifiques sont mobilisés – un peu comme lorsque l’Eglise fait appel à la science pour authentifier le saint suaire. Cependant, aucun résultat d’analyse ne permet de trancher en faveur de l’un ou de l’autre. A l’usure, c’est le «camp» français qui gagnera, en partie faute de combattants : Blunt est mort en 1983 et Mahon est très âgé [il meurt en 2011 à 100 ans, ndlr]. En 1994, la version des frères Pardo est «publiée» par Jacques Thuillier et apparaît dans le catalogue d’une exposition du Grand Palais sur Poussin. La justice parachève le travail des conservateurs et historiens d’art. En effet, la famille qui avait vendu le tableau comme une copie à bas prix demande l’annulation de la vente et l’obtient. Cette fois, ce sont des juges qui disent qu’il s’agit bien du tableau de Poussin. A la suite de quoi, l’Etat le classe Trésor national – ce qui lui interdit toute sortie du territoire. La famille revend alors le tableau au musée des Beaux-Arts de Lyon pour 17 millions d’euros. La toile initialement jugée médiocre par Le Bernin s’est métamorphosée en chef-d’œuvre.
Et une nouvelle Fuite en Egypte apparaît…
Elle est exposée dans un petit lieu, tenu par une association, qui est ouvert une fois par mois à Verrières-le-Buisson, en région parisienne. Le président de l’association constate une ressemblance évidente entre le tableau et celui dont il voit la photo dans les journaux. Il contacte le musée des Beaux-Arts de Lyon qui envoie un jeune historien d’art chargé de rédiger un texte sur les copies du tableau. Avant même tout examen, la toile ne peut qu’être une copie. La chose est réglée par avance, car on s’est suffisamment battu. Thuillier et Rosenberg ont désigné le tableau autographe, un musée a acquis à grands frais le chef-d’œuvre désigné, les Anglo-Saxons n’ont plus de combattants, la collectionneuse nord-américaine meurt en 2013 et on en reste là (2). Finalement, tout le jeu a consisté à produire de la certitude avec une dose d’incertitude majeure.
La réalité d’un chef-d’œuvre repose sur des croyances collectives. Le culte de l’œuvre d’art a ses grands prêtres et sa liturgie…
Il faut se demander qui a le pouvoir de sacraliser un objet profane et qui tient la baguette magique, qui change le crapaud en prince charmant. Les frères Pardo sont des marchands. Ils ont une intuition, engagent beaucoup d’argent, mais ne détiennent pas la baguette. Ils demandent à un historien italien peu reconnu de légitimer leur version de la Fuite en Egypte. Celui-ci l’écrit… Mais tout le monde s’en fiche. Ils sollicitent alors Thuillier et Rosenberg qui, eux, connaissent la formule magique. Encore faut-il qu’elle soit écrite et publiée. Il se passe six ans entre le moment où Thuillier laisse entendre oralement qu’il pense que c’est le bon et celui où il l’écrit en 1994. A ce moment-là seulement, la magie opère. S’il existe de telles batailles, c’est que tout le monde – Etat, marchands, historiens d’art, conservateurs, commissaires-priseurs – croit en l’art, participe au culte de l’authenticité et du génie, admet l’existence de hiérarchies entre peintres et souhaite s’approprier une œuvre d’un grand nom de la peinture. Si le jugement ne peut être pur, c’est que tous les acteurs ont intérêt à ce que «leur» version soit la bonne. Chacun veut profiter de ce morceau de sacré.
Pourquoi dites-vous que l’œuvre d’art a remplacé les reliques et que le visiteur de musée est l’objet d’un envoûtement ?
L’histoire des reliques, qui a commencé au IVe siècle, a largement préfiguré l’histoire de l’art : de simples ossements deviennent des reliques vénérées, qui attirent des milliers de visiteurs dans les églises ; des luttes s’engagent entre ceux qui prétendent posséder les bonnes reliques, etc. Aujourd’hui, nous croyons, quand nous allons au musée, avoir un rapport direct avec les œuvres, mais nous éprouvons une émotion uniquement parce que tout a été fait, collectivement, pour qu’elle puisse s’exprimer. Le musée et tous les experts qui certifient l’authenticité des œuvres transforment l’ordinaire en exceptionnel, le profane en sacré. Quand l’artiste Banksy installe ses œuvres sur un trottoir à New York, il ne les vend qu’à quelques dizaines de dollars alors qu’elles en «valent» plusieurs dizaines de milliers dans les galeries. La sacralisation de l’art a commencé au Moyen Age quand on a commencé à comparer les poètes au Créateur. Ça n’a rien d’anodin : en en faisant des démiurges, on rattache les artistes au pôle dominant du monde social, donc du côté du sacré, de ce qu’il faut protéger et respecter. On retire les objets d’art de la circulation ordinaire et, de la Renaissance au XVIIIe siècle, les artistes vont progressivement émerger comme groupe social en se séparant des artisans qui, eux, fabriquent des objets profanes. Le musée, qui apparaît au XIXe siècle, n’est que l’aboutissement de cette longue histoire.
A travers l’exemple d’un tableau, vous voulez démontrer que notre monde est loin d’être désenchanté. Nos sociétés occidentales font-elles encore place au sacré ?
Il ne faut pas confondre la religion et le sacré, ce qui arrive souvent en France où nous pensons qu’avec la Révolution française et les Lumières, la raison l’a emporté sur les croyances. Certes, les religions se sont affaiblies comme principe structurant l’ensemble des sociétés, mais la pensée magique existait avant les religions, et continue d’exister sans elles dans toutes les situations où il y a du pouvoir. La division entre sacré et profane apparaît dès lors qu’on distingue ce qui est important de ce qui est insignifiant, ce qui doit être manipulé avec précaution de ce qui peut être utilisé sans attention particulière. On le voit bien avec l’œuvre de Poussin : le même objet qui avait été entreposé dans un bâtiment de ferme se retrouve manipulé avec des gants blancs quand il arrive au musée des Beaux-Arts de Lyon.
Et vous, avec cet intimidant livre de près de 600 pages construit comme un raisonnement philosophique à la manière de Spinoza, avez-vous voulu faire votre chef-d’œuvre?
Pff… (embarrassé). C’est un travail où de nombreux éléments s’emboîtent comme dans une mécanique de haute précision, un travail qui m’a demandé un temps fou et pour lequel je n’ai eu que très peu d’argent. Cet ouvrage a une conception grothendieckienne (3) : le cas particulier de l’histoire de la Fuite en Égypte ne prend son sens que comme un cas parmi d’autres d’un problème beaucoup plus général dont je parle au début du livre. Je porte cette problématique de l’opposition du sacré et du profane, et de son articulation à des rapports de domination, depuis ma thèse de doctorat… J’ai mis ça sous le boisseau pendant vingt-cinq ans, et là j’ai trouvé l’occasion d’y revenir et me suis enfin autorisé à le faire. La taille du livre est imposante et sa forme a un côté abrupt, c’est vrai, mais il faut écrire les livres qu’on ressent la nécessité d’écrire et ne pas se demander si ça va être lu ou si ça va plaire. Le lecteur peut d’ailleurs parfaitement commencer par l’histoire du Poussin, ou ne lire que les “Propositions” [en gras dans le livre]… En fait, je crois que j’écris pour la postérité (il rit).
(1) «Velásquez», au Grand Palais jusqu’au 13 juillet. «Poussin et Dieu», au Louvre, jusqu’au 29 juin. «Les Clés d’une passion», à la Fondation Louis Vuitton, jusqu’au 6 juillet.
(2) Aux dernières nouvelles, Pierre Rosenberg n’est pas passé à Verrières-le-Buisson.
(3) Alexandre Grothendieck, l’un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, recherchait toujours la plus grande généralisation possible pour résoudre des cas particuliers.